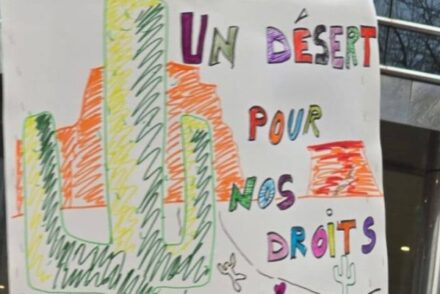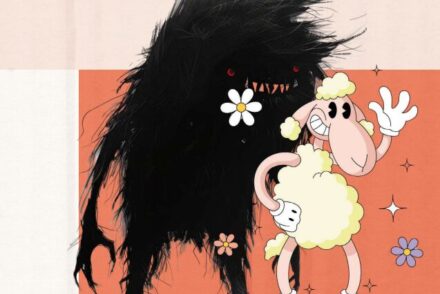Lunch-débat « Wokisme/antiwokisme : réfléchir ensemble autrement »
 Le 12 décembre 2024, les Équipes Populaires ont organisé un lunch-débat Contrastes sur le wokisme et son pendant l’antiwokisme au sein des murs accueillants du Garcia Lorca à Bruxelles. Ce débat faisait suite au numéro de Contrastes de l’automne 2024 : « Antiwokisme : tenter de voir autrement ». Pour nous accompagner dans cette réflexion, Martin Deleixhe, politologue qui était déjà intervenu dans cette édition de Contrastes, et François Polet, sociologue et chargé de mission au CETRI, ont tous les deux répondu présents à notre invitation et nous les remercions une fois de plus chaleureusement.
Le 12 décembre 2024, les Équipes Populaires ont organisé un lunch-débat Contrastes sur le wokisme et son pendant l’antiwokisme au sein des murs accueillants du Garcia Lorca à Bruxelles. Ce débat faisait suite au numéro de Contrastes de l’automne 2024 : « Antiwokisme : tenter de voir autrement ». Pour nous accompagner dans cette réflexion, Martin Deleixhe, politologue qui était déjà intervenu dans cette édition de Contrastes, et François Polet, sociologue et chargé de mission au CETRI, ont tous les deux répondu présents à notre invitation et nous les remercions une fois de plus chaleureusement.
Un petit retour dans le temps est nécessaire pour recontextualiser ce qui a amené les Équipes Populaires à investiguer ce terme, souvent nébuleux et clivant. Comme toujours, c’est au travers des questionnements des membres et militants que l’idée d’aborder le sujet a émergé. Le wokisme et l’antiwokisme sont partout dans les médias et discours politiques, mais leur compréhension varie d’une personne à l’autre à travers des définitions qui ne sont pas toujours claires. Fait interpellant, certains de nos membres craignent presque de « mal penser », c’est-à-dire de penser à contre-courant de ce que prescrirait le wokisme qui, dans nombre de milieux militants, jouit d’une certaine légitimité. Il nous a dès lors paru essentiel de nous emparer de ces questionnements et de nous attarder sur ces notions et ce qu’elles recouvrent, en tentant de nous distancer des affects pour aborder ce sujet de manière critique, constructive mais également apaisée.
Le wokisme, vrai phénomène ou fantasme de la droite ?
Pour rentrer dans le vif du sujet, une même question était posée à nos deux intervenants : « Alors ce fameux wokisme, existe-t-il ou non ? ». Pour Martin Deleixhe, le wokisme n’existe pas en tant que tel. C’est une création intellectuelle à laquelle on attribue tout un ensemble de discours qui eux, existent bel et bien. Ce qui les rassemble aux yeux des « antiwokisme », c’est qu’ils s’articulent essentiellement autour de l’enjeu de la discrimination. L’écueil de ce terme, c’est qu’il met toute lutte qui aspirerait à l’égalité et l’inclusivité dans le même panier. Martin Deleixhe rappelle qu’il faut faire attention à la diversité de ces mouvements qui luttent contre les discriminations et pour la protection des minorités, qui n’ont pas tous nécessairement ni le même agenda, ni les mêmes revendications. Comme le souligne notre interlocuteur, « derrière cette construction du wokisme, il n’y a pas seulement une volonté descriptive d’identifier une nouvelle idéologie, il y a également une charge polémique ». Cette charge polémique se manifeste à deux égards : premièrement, elle fustige la dénonciation des discriminations systémiques, c’est-à-dire qu’elle s’oppose à l’idée que les discriminations seraient inscrites dans les institutions et ne seraient pas uniquement le fait de relations interpersonnelles.
Comme le rappelle notre interlocuteur, pour toute une partie de la droite, notamment américaine, cet argument est inaudible pour qui se situe dans une perspective ultralibérale, où ce qui existe, ce sont les relations entre les individus. Deuxième critique qui lui est adressée, le wokisme, en présentant une vision du monde perçue comme manichéenne (oppresseurs contre oppressés), ferait fi de la délibération démocratique. Pour résumer le propos de Martin Deleixhe, le wokisme en tant que tel n’existe pas, ce qui existe en revanche c’est une pluralité de mouvements progressistes qui n’ont pas tous les mêmes enjeux et connaissent même des pluralités en interne. L’antiwokisme par contre existe lui bel et bien au travers d’« une restructuration, une recomposition d’un certain paysage idéologique, qui est favorisé par le fait que tout le monde peut taper sur le même ennemi, à savoir les « woke » ».
François Polet fait quant à lui le constat que le terme « wokisme » est aujourd’hui chargé par la droite de connotations empreintes d’un refus de l’expression de luttes minoritaires. Vu la charge sémantique qui y est rattachée, il semble contreproductif pour la gauche de reprendre ce qualificatif à son compte. Comme Martin Deleixhe, il s’inscrit donc en porte-à-faux d’une vision de ces luttes comme homogènes dans leurs revendications et stratégies et souligne la diversité des mouvements qui les portent. François Polet s’inquiète cependant des dérives qui peuvent toucher ces luttes et pointe qu’« il y a des choses problématiques dans les pratiques, dans les méthodes et dans les discours de certaines composantes des mouvements minoritaires ». Cela s’explique entre autres selon lui par des « mutations sociétales profondes, avec des changements en termes de sensibilité aux discriminations qui sont elles-mêmes liées à des mutations de l’individualisme, du sentiment démocratique ou des mutations ». Avec cette nouvelle sensibilité qui émerge, il y a des attentes que ça aille plus vite.
Or, la société évolue plus lentement que ce que les militants le voudraient, créant un décalage difficile à concilier entre attentes et situation vécue par ces groupes minoritaires, qui auront dès lors parfois tendance à entrer dans des démarches caricaturales. Ainsi, François Polet insiste sur le danger de l’essentialisation, qui peut s’illustrer par exemple par « le fait de systématiquement renvoyer les gens à leur appartenance raciale sur toute une série de questions ».
Genèse du wokisme

De g. à dr. François Polet, docteur en sociologie de l’ULiège et chargé d’étude au Centre tricontinental (CETRI) et Martin Deleixhe, enseignant, chercheur à l’ULB au sein du département de sciences politiques
Selon Martin Deleixhe, le wokisme en tant que concept a été créé par l’extrême droite. Certes, le terme « woke » vient originellement du mouvement Black Lives Matter1 aux USA, mais c’est l’extrême droite qui en a fait une idéologie contre laquelle il conviendrait de lutter. Au sein même des mouvements militants, Martin Deleixhe rappelle qu’il y a toujours eu des franges plus ou moins radicales, des positions plus centrales ou modérées, et donc, forcément, des tensions. Ce qui est inédit selon notre interlocuteur, c’est que « ces mouvements de gauche ont utilisé des catégories forgées par l’extrême droite pour discuter de leurs dissensions internes ». Le constat de l’extrême droite pour forger ce fameux terme de wokisme était le suivant : au plus les gens font des études, au plus ils votent démocrates. Partant de là, il fallait trouver un moyen de décrédibiliser ces discours. L’une des stratégies va être de présenter les universités américaines comme phagocytées par une sorte d’intelligentsia de gauche qui aurait le monopole sur l’enseignement aux USA. Critique visant à la base le monde académique, elle a percolé dans la société civile pour viser à leur tour les mouvements sociaux.
Antiwokisme de droite et antiwokisme de gauche
Cet antiwokisme dont nous parlons dans le paragraphe précédent pourrait être qualifié d’antiwokisme de droite, fondé sur une base raciste et réactionnaire. Mais il existe, dans le champ de la gauche, des militants critiques qui se distancient des stratégies que l’on attribue au camp « woke » et que l’on pourrait qualifier très caricaturalement d’« anti-wokistes de gauche ». Leur principale critique porte sur le discours et les pratiques militantes que ces groupes « woke » utilisent, et le risque d’essentialisation qui en découle. Certains défendent également une grille de lecture marxiste où la classe sociale demeure l’enjeu central et peinent à se retrouver dans ces nouvelles luttes minoritaires. Enfin, une partie des progressistes de gauche s’inquiète de l’effet d’autocensure que font peser ces discours qualifiés de « woke » dans les débats. Pour autant, il est important de souligner que contrairement à l’antiwokisme « de droite », personne à gauche ne semble se revendiquer de cette étiquette.
Le mot de la fin
Les échanges, passionnés et riches, de ce temps de midi témoignent de la vivacité de ces questions dans les milieux militants. Et nous invitent à nous poser pour reconsidérer nos propres biais. Deux grilles de lecture peuvent coexister. Il est bien sûr primordial, pour étudier un fait social, de comprendre et de déconstruire les narratifs qui structurent et justifient les oppressions systémiques. Les mouvements antiracistes, féministes, décoloniaux nous ont montré comment ces imaginaires imprègnent l’ordre social dans son ensemble, et doivent être appréhendés dans leur globalité et leur interconnexion. Ils nous invitent à entendre le vécu de minorités, et à penser à partir de ces témoignages. Ils nous rappellent aussi très opportunément que notre propre pensée est située. Pour autant, cette démarche ne doit pas être dogmatique et admettre
le débat en son sein. On ne peut rejoindre l’autre en l’ostracisant. Cette posture invite aussi à prendre en compte les rapports de pouvoir et de classe qui se rejouent également au sein des minorités comme des milieux militants, reflet de notre société toute entière. Et à dépasser nos clivages pour lutter ensemble pour ce qui nous rassemble, la conviction d’un monde plus juste, plutôt que ce qui nous sépare. Au risque de laisser un boulevard à la récupération politique d’une droite toujours plus hégémonique.