INTERVIEW – Jean Kabuta : Le kasàlà, pour faire l’éloge de nous (Mars-Avril 2021)
Propos recueillis par Laurence Delperdange, Contrastes Mars-Avril 2021, p 8–11
Dans les pages dédiées au Kasàlà, sur le site du département des langues et cultures africaines de l’Université de Gand, on pouvait lire : « Nous vous invitons à partager un rêve : amener l’humain, par-delà la famille, l’ethnie, la couleur de la peau, la classe sociale à développer une solidarité citoyenne, à retrouver sa noblesse, à se prendre en charge… » C’était en 2006. Depuis, le kasàlà, véritable cadeau venu d’Afrique, se pratique sur tous les continents. Il nous a semblé qu’en ces temps troublés, il peut être un solide et sage gouvernail pour se renforcer, contre vents et marées. Rencontre avec Jean Kabuta, semeur de kasàlà dans le monde entier.
Bien avant les théories freudiennes, de nombreuses sociétés sur le continent africain pratiquaient un art dont les bien- faits contribuaient à l’harmonie des relations humaines, à l’équilibre intérieur : le kasàlà1 – chant public de la personne ; un genre littéraire qu’on peut traduire par autopanégyrique ou autolouange. Jean Kabuta qui a grandi en Belgique, après une enfance africaine, a exploré cette pratique qui fut le thème de sa thèse de doctorat Eloge de soi, éloge de l’autre, parue en 2003.2 Jean Kabuta sème depuis de nombreuses années le kasàlà en Belgique, en Asie, en Afrique, au Québec, touchant des publics de 3 à 93 ans ! Il anime des ateliers dans différents endroits du monde et propose des formations. Il vit aujourd’hui au Québec où il a fondé l’EKAR, l’Ecole du Kasàlà de Rimouski.
Contrastes : Pouvez-vous donner une définition du kasàlà, ce mot énigmatique pour ceux qui le découvrent ?
Jean Kabuta : Il s’agit d’un texte dans lequel l’individu se considère comme un objet esthétique, digne d’intérêt et d’admiration au même titre que d’autres objets présents dans l’univers. Ne peut valablement faire de l’autolouange que la personne capable de rire de soi, de jouer sa vie. Créer un texte, c’est se créer soi-même. C’est un genre de la littérature orale qui plante ses racines sur les terres africaines : en Afrique subsaharienne, au Rwanda, au Burundi, au Kasaï, en Afrique du Sud… On trouve des traces de ce genre littéraire dans le désir fondamental chez l’homme de réussir, d’être reconnu, d’être quelqu’un. Il est un outil puissant qui va stimuler l’énergie qui permet d’entreprendre de grandes actions ou de faire face à des situations difficiles, outre le fait qu’il peut aussi simplement servir à faire connaître la personne. Pour se sentir bien, il faut avoir une bonne estime de soi.
Le kasàlà ? Rien d’autre…
Qu’une parole efficace qui ouvre la voie
Aux ressources fabuleuses enfouies au fond de soi
Une énergie qui actionne un levier
Qui propulse l’homme au-delà de soi-même Une invitation à croire en soi
A s’autocréer à recréer le monde ». J.
Un exemple de kasàlà
Je suis Lubuta Bênyì Oiseau nocturne
Qui veille pendant que d’autres dorment
Source d’inspiration pour le poète et le savant
Ma généalogie est longue
Fils de Lucy l’Etincelle initiale
Etoile bénéfique Etoile prolixe
Qui engendra les femmes et les hommes
Qui allèrent porter la vie humaine
Aux quatre coins de la planète…

jean-kabuta-enfant-regard
♦ A l’origine, le kasàlà était pratiqué dans des circonstances particulières, on le déclamait pour des personnes tenant un rôle important dans la communauté, lors des rites initiatiques dans des sociétés éloignées de la nôtre. A-t-il fallu adapter cette pratique à nos façons de faire société ?
♦ En effet. Aujourd’hui, le kasàlà contemporain s’est adapté aux nouveaux contextes et il permet d’apprendre à poétiser la vie. Pour cela, il met l’accent sur la beauté et la force de régénération présentes en chaque personne. Comme parole, il renouvelle la vision de soi, de l’autre et du monde. C’est une parole qui circule librement dans la communauté, libre de droits d’auteur. Il enseigne l’émerveillement devant le mystère de la vie, malgré l’existence de la souffrance. Comme posture, il aiguise la présence à l’essentiel et invite à le célébrer.
♦ Quelles sont les raisons qui vous ont amené à y croire au point de vouloir le partager aux quatre coins de la planète ?
♦ Alors que l’éducation africaine décourage de se féliciter soi-même, je découvrais avec cette pratique, une parole qui faisait l’inverse. Mais pas n’importe comment : par un langage poétique, lequel permet de faire ce qui est normalement proscrit du langage habituel. Il s’agissait de célébrer la vie dans la personne par la louange, par un récit se focalisant sur la biographie ou un fragment de biographie en y ajoutant une dimension à la fois poétique et épique. Le bénéficiaire apparaît ainsi comme un hé- ros, perçu dans sa capacité de relever des défis. Le héros moderne lutte contre des croyances, l’ignorance, la peur, la misère… Il lutte pour acquérir la connaissance, la reconnaissance, la liberté. Il veut, légitimement reconquérir sa place parmi les humains. Le kasàlà m’est apparu comme une école de la dignité et de la résistance émerveillée, une occasion de renaissance
♦ Comment caractériseriez-vous un langage poétique ? Est-il accessible à chacun ?
♦ C’est un langage plein de silences. On essaie de faire le moins de bruits possibles… Cela donne lieu à de l’ambiguïté. Alors que le langage courant doit être le plus précis possible. En poésie, ce que je communique touche davantage à l’affectif et au symbolique. L’ambiguïté permet d’autres interprétations. Elle laisse la place à l’autre. Elle peut contribuer à la création de l’œuvre. Ce que l’autre va percevoir n’est pas forcément ce que j’y ai mis. Dans le langage courant, on évite la redondance. Dans le langage poétique, elle est la bien- venue. Elle donne accès à un monde intérieur. Chacun y met sa propre voix.
♦ Quelle place pour l’autre s’il s’agit de se louer soi-même ou comme vous le dites, de louer la vie qui est en soi ?
♦ Le concept d’autolouange m’a paru très vite réducteur par rapport à cette pratique africaine. Louange a, en outre, une connotation religieuse… Lorsque j’ai souhaité initier les Occidentaux, j’ai utilisé ce terme mais j’ai réalisé que le mot kasàlà permet de dire la totalité du concept puisqu’il intègre la notion de soi mais aussi de l’autre. Ce mot est issu du Cilubà (langue bantoue parlée dans les provinces du Kasaï en RDC). Aujourd’hui, je parle du kasàlà contemporain. Il est différent de celui de mon arrière-grand-père. Je suis moi-même un mélange d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique. Il se nourrit aussi de mes pérégrinations et de la découverte de pratiques telles que le yoga, le Zen… Le kasàlà contemporain associe l’écriture à l’oralité. Il s’enrichit d’autres valeurs tout en intégrant les valeurs africaines telles que la célébration, la gratitude, la connexion, l’ubuntu, un mot qui n’a pas d’équivalent en français mais qu’on pourrait traduire par « Je suis un être humain par et pour les autres », proche des concepts d’humanité et de fraternité. Le kasàlà aujourd’hui intéresse des personnes de tous âges et de tous horizons… Récemment une dame noire habitant New York m’a contacté. Elle souhaitait participer à nos ateliers « à dis- tance ». Je travaille aussi avec un groupe de jeunes Sénégalais, avec des jeunes afro-descendants de Mons en Belgique… Des ateliers sont proposés en milieu pénitentiaire, dans des classes de l’école primaire au Québec.
♦ Qu’est-ce qui, selon vous, explique cet engouement entre autres, chez nous en Belgique ?
♦ Ce qui m’a frappé lors de mon arrivée en Occident, au début des années soixante, est la détresse que j’y ai rencontrée. A mon arrivée à Bruxelles, j’ai participé aux conférences de Saint-Vincent de Paul. Nous apportions des plats préparés aux personnes âgées, contre une petite somme d’argent ; une bonne chose puisque ça leur donnait la liberté de les critiquer… Je sentais ces personnes vraiment abandonnées. Alors qu’au Congo, plus tu vieillis, plus tu gagnes de la valeur, en Belgique, je découvrais l’inverse. Plus tard, lorsque j’ai enseigné en secondaire, j’ai rencontré des jeunes en dépression. Dans le quartier où j’habitais, en Brabant wallon, cinq personnes se sont suicidées, dans une période de neuf ans. Tout cela m’a convaincu qu’il y avait un travail à faire pour que les personnes relèvent la tête, se sentent bien, retrouvent l’estime de soi. Le kasàlà recolle les liens, relie la personne à sa particularité, à sa communauté, à sa terre. Il appelle à se si- tuer socio-culturellement, sociologique- ment, géographiquement, dans l’histoire. Il s’agit aussi de recréer un espace de paroles, de créer du beau à même le terrible. Mais aussi de relier les générations, de ré- concilier, de créer de la communauté, du lien social et de lutter contre l’individualisme. Ce que permet le travail langagier. Le kasàlà est une pratique rituelle pour réenchanter le monde.
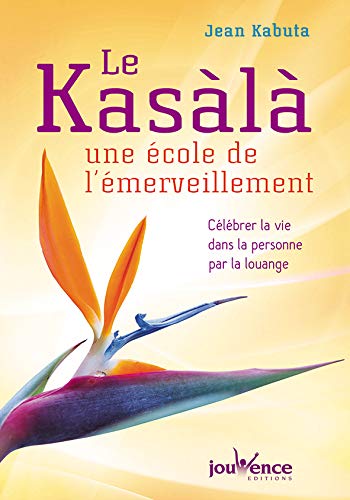
POUR EN SAVOIR PLUS :
Jean Kabuta: l’éloge comme solution à la déprime, de Jean-Louis Bordeleau, dans Le Devoir, 14 jan- vier 2021 www.shamengo.com/fr/pion- nier/94-jean-kabuta/ www.kasala.ca
Hommage à George Floyd
J’arrive pas à respirer…
… Je m’appelle George Floyd Breonna Taylor Botham Jean Stephon Clark Philando Castile Alton Sterling Jamar Clark Freddie Gray Walter Scott Tamir Rice Laquan MacDonald Michael Brown Eric Garner
Je porte d’innombrables autres noms
Reçus au cours de nombreuses décennies depuis le règne du Ku Klux Klan
Depuis le temps de la traite depuis les cales sombres des bateaux négriers
Où durant des semaines de traversée j’ai manqué cruellement d’air
Ne suis-je pas Celui-qui-manque-d’air-depuis-cinq-siècles-entiers
Depuis ces sinistres années 1440 où captif déshumanisé du continent razzié
Je fus déporté vers la péninsule ibérique puis vers les Antilles et autres Amériques
Comme marchandise comme esclave monnayable et corvéable à merci
Avec la bénédiction des églises saintes et le silence des philosophes dits éclairés ?Réputé bête dangereuse et indésirable je suis toujours pourchassé toujours traqué
Los Angeles ou New York ou Chicago Texas ou Minneapolis ou Montréal
Du nord au sud d’une côte à l’autre où que j’aille je suis victime de profilage racial
Je suis l’animal qu’on abat sans vergogne sans craindre aucune sanction sérieuseOr à la fois fragile et puissant un genou obstiné me tue qu’il ne puisse m’anéantir
Je suis Vie-qui-ne-s’éteint-point sans provoquer un séisme sans ébranler le monde
Braves gens réunis dans cette agora accueillante ce dimanche 7 juin de l’an 2020
Mon cœur est rempli d’allégresse et d’espoir Il chante il danse il rend grâce
D’être entouré de sœurs et frères au cœur aimant aux couleurs arc-en-ciel
Pour dénoncer l’injustice le mépris la violence pour dénoncer le racisme dégradant
Pour proclamer devant le monde et la nature témoins notre commune noblesseJean Kabuta, juin 2020
♦ Jeanne-Marie Rugira, professeure à la faculté de psychologie sociale à l’Université de Rimouski au Québec (UQAR), dresse ce constat : « On assiste aujourd’hui à une rupture de la transmission qui n’est pas sans conséquences sur le plan existentiel. Qui produit, une sorte d’errance, un manque d’ancrage, une cassure du sentiment d’appartenance qui crée du mal-être sur le plan psychologique. L’histoire collective est remplie de mépris de soi, de mépris collectif. La colonisation, l’évangélisation… ont laissé des traces ». La pratique du kasàlà, entrée dans l’Université, pourrait donc permettre de renforcer le lien davantage encore mis à mal par le confinement ?
♦ Je vois effectivement le kasàlà comme un art du lien. Il apporte cette chose dont on a tant besoin. Être en contact fort avec l’autre. Cela peut passer aussi par la célébration d’un lien, d’une personne avec la- quelle nous n’avons a priori pas d’affinités. Je ne peux célébrer l’autre si je ne l’aime pas. Le fait que l’on fasse l’effort de voir qui est cette personne, d’avoir la curiosité de chercher en elle ses qualités est un travail à faire sur soi. Il s’agit d’apprendre à être curieux de l’autre… Ici à Rimouski, j’ai créé l’EKAR, l’école du kasàlà. C’est un lieu où on peut apporter un peu d’espoir à l’humanité car le kasàlà est une pratique de la joie, de l’émerveillement. Nous avons proposé des séances en ligne pendant le confinement. On en avait besoin.
 ♦ Cette pratique, outre le bien qu’elle procure à la personne elle-même et au groupe, pourrait-elle s’inscrire dans une dynamique d’émancipation sociale et de justice sociale ?
♦ Cette pratique, outre le bien qu’elle procure à la personne elle-même et au groupe, pourrait-elle s’inscrire dans une dynamique d’émancipation sociale et de justice sociale ?
♦ On peut tout à fait écrire un kasàlà de la révolte, de la colère vitale, plus politique. Un kasàlà qui défend la dignité humaine, qui exprime un refus. Le kasàlà devient alors un mode de vie, un discours intime pour provoquer le changement. En juin, nous avons organisé une marche en sou- tien au mouvement Black Lives Matter. J’ai écrit un kasàlà à cette occasion. A notre appel, mille-cinq-cents personnes se sont rassemblées sur une place. Nous avons lu un kasàlà en hommage à Georges Floyd (voir extrait ci-après). Alors que les liens se détricotent, que des proches meurent sans qu’on puisse leur rendre un dernier hommage avec le réconfort des proches, que les contacts sont limités, que la no- tion d’essentiel est étrangement attribuée, les questions « Qui suis-je ? », « Dans quel monde et pourquoi vivons-nous ? » sont plus que jamais posées. Ne pas – plus – trouver les réponses crée un tel vide en soi, qu’on soit jeune ou vieux. C’est à ces questions que la pratique du kasàlà invite à répondre. Et à partager.
1. Kabuta Jean, Le kasàlà : une école de l’émerveille- ment, Ed. Jouvence, 2015
2. Ngo Semzara Kabuta, Eloge de soi, éloge de l’autre, Ed. Peter Lang, 2003
–
–
